

Col de Montjoie
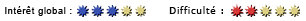

Joli mois d'octobre, où les randonnées ont une autre saveur; Les couleurs superbes qui mettent encore plus de valeur aux reliefs et le soleil qui continue d'être bien présent mais, qui "cogne" avec quand même moins de violence. La randonnée du jour est dans cette ambiance. Son accès facile ainsi que son parcours bien fléché, avec un dénivelé tout à fait correct jusqu'à "La mère de l'Eau" qui correspond à la fin de la piste carrossable.
Ensuite le dénivelé s'accentuera un peu plus, jusqu'au col pendant environ une heure de marche. Mais pas question de joindre cet endroit en voiture, le départ se situe au bout de la route goudronnée, dans un cadre des plus agréables, qui peut à lui seul être le prétexte d'une sortie, le lac de la Gde Léchère. Cet endroit ombragé, agrémenté de tables de pique-nique, avec comme décor, les sommets environnants ne pourra que vous ravir.
Le Lac de la Grande léchère.
Ci-dessous: pendant la montée au Grand pré, après avoir quitté la piste.

Accès à la rando: Depuis St Avre - La Chambre, prendre la direction de Notre-Dame du Cruet, Montgellafrey. A l'entrée du village, tourner à gauche, direction le lac de la Grande Léchère. Aucun rique d'erreur, fléchage parfait
Carte IGN 3433 ET Voir Parcours
Altitude de départ : 1680 m.
Altitude La Mère de l'eau : 2010 m.
Altitude de Montjoie : 2253 m.
Dénivelé : 573 m.
Temps : 2 heures (aller)
Après avoir jeté un oeil sur le lac, prendre la piste et la suivre jusqu'à son terme ou, vous pouvez faire comme moi, afin d'éviter à rester constamment dessus, au bout de 500 m environ de marche, j'ai pris un petit sentier qui monte à gauche de la piste en direction du "Grand Pré", photo ci-contre puis, aller en direction de la croix qui dépasse des arbres, suivre le sentier qui descend légèrement en la contournant par la droite et, au bout d'un moment on retrouve la piste quittée plus bas. Cela fait un petit dénivelé supplémentaire qui est assez agréable et qui rend la montée un peu moins monotone.


Tout doucement maintenant, on sort de la forêt, la montée est douce et la vue s'élargit, le paysage est magnifique avec tous ces arbrisseaux qui changent de teinte, au centre, une vue sur la station de St François longchamp et à droite on ne manque pas de remarquer le Cheval Noir.
Vous poucez aussi accéder à cette randonnée par d'autres endroits. Il vous suffira d'aller directement depuis la route du Col de la Madeleine (Longchamp 1650, ou le virage 1896 m), ou encore par Epierre à l'aide des pistes et chemins forestiers.



Voici maintenant "La Mère de l'eau", et un sentier remplace enfin l'interminable piste. La montée est un peu plus ardue mais, le sommet n'est plus très loin, à peine une heure. À gauche, vue sur le Roc Rouge, où je vais terminer ma balade afin d'avoir une vue encore plus étendue et à droite, au bout du sentier que l'on voit, l'arrivée au col de Montjoie.

Arrivé au col, un spectacle saisissant se trouve face à moi, je suis impressionné en découvrant une importante série de paravalanches de pierres qui ont été construits il y a déjà bien longtemps. A quelques dizaines de mètres du col adossé à un gros rocher se trouve un abri qui servait aux gens d'Epierre qui ont contribué à leur construction. Ils montaient à pied et restaient sur place en s'abritant dans cet endroit qui comporte des ouvertures mais, sans fenêtres ni portes d'installées, ce qui laisse à penser que ce ne devait pas être la fête tous les jours.


L'abri que les ouvriers utilisaient existe toujours et a été tout dernièrement rénové, puisque mon passage 07-10-2010 coïncidait avec la fin des travaux effectués par le personnel du RCM (restauration des constructions de montagne) car, il était en très mauvais état; les promeneurs pourront donc à nouveau l'utiliser lors de leur passage.
Historique des paravalanches : Les travaux correspondant aux constructions de banquettes et de murs paravalanches de grande envergure se sont décidés et commencés dès 1908, pour être poursuivis jusqu'à la première guerre mondiale. L'entreprise qui effectuait ces travaux employait une douzaine d'ouvriers qui travaillaient tout l'été et logeaient dans des abris situés au col. Les toits de ces abris étaient confectionnés dans une variété de toiles goudronnées, maintenues par des pierres et démontés l'hiver. Le ravitaillement était fait par des mulets depuis Montgellaffrey ou Le Planay. (la route du col de la Madeleine n'existant pas à cette époque). En 1914, il avait été ainsi réalisé une baraque, un barrage en maçonnerie et, environ 20 kms de sentiers, 2400 ml de murs divers et 1600 ml de banquettes. Après la guerre de 1914-1918, quelques travaux d'entretien ont été entrepris pour réparer les murs et banquettes les plus dégradées. Bien que le programme de construction de murs et de banquettes ait été entièrement réalisé, le régime des avalanches n'a presque pas été modifié. En effet, comme l'a montré l'expérience acquise depuis une trentaine d'années, ce type de correction a une efficacité très limitée. De tels ouvrages augmentent la rugosité du sol et peuvent retenir les avalanches dont le plan de glissement est voisin du sol ; mais ils sont sans effet sur les autres qui sont de loin les plus nombreuses, car ils sont très rapidement comblés et recouverts par la neige. Ainsi la plupart des avalanches de neige poudreuse, qui sont les plus désastreuses, ne sont nullement supprimées par un tel dispositif. Les avalanches subsistent également parce que la correction est partielle; quelques avalanches importantes prennent naissance dans les zones qui n'ont pas fait l'objet de travaux. Leur correction serait, sinon impossible, du moins encore plus chère que celles dont la correction a été tentée. Par ailleurs, les crues du torrent se sont nouveau faites plus rares après la période critique qui a suivi l'éboulement de Roche Bénite (1895). Après la crue de 1901 et jusqu'en 1952, il n'y a eu que 6 crues dont deux ont inondé et engravé des bâtiments.
Les ouvrages paravalanches existants étant très peu efficaces, leur disparition n'est pas susceptible d'entraîner une aggravation sensible des risques, qui sont d'ailleurs limités, pour les habitants de la vallée. Du reste, la dégradation et la disparition de beaucoup d'entre eux depuis 1937 ne s'est traduite par aucune recrudescence notable de l'activité torrentielle. Il n'y a donc pas lieu de les entretenir, d'autant plus que la dépense d'entretien serait, faute de moyens d'accès plus aisés, très élevée. C'est d'ailleurs la politique qui a été suivie depuis maintenant plus de quarante ans. Cette décision est sentimentalement difficile à prendre, car ces ouvrages ne manquent pas d'allure et ils ont été édifiés au prix de grosses difficultés, mais leur entretien est d'avantage du ressort de la conservation des sites et monuments historiques.


Après le col, un petit tour dans les environs, en bout de crête afin d'avoir une vue sur le rocher de Sarvatan et direction le Roc rouge qui n'est pas loin (alt 2375 m), avec vue sur le col et son abri et au loin le col de la Madeleine, avec à sa droite le Cheval Noir, dont le détail de la rando figure sur une page du site.

